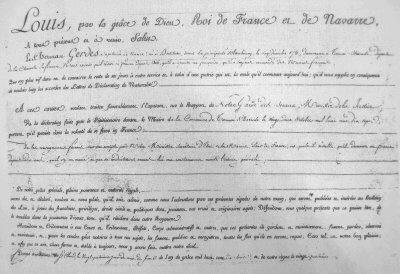|
|
|
 |
| |
|
 |
| |
|
Les familles issues de
l'immigration |
| |
| De plus en plus nombreux sont
ceux qui ont, ou découvrent une origine familiale extérieure au territoire
de la France métropolitaine. Ce sera généralement la cause de difficultés
nouvelles. |
| |
|
Afrique Noire
- Algérie -
Belgique - Guadeloupe -
Indochine -
Luxembourg - Madagascar -
Martinique - Maroc
- Québec -
Réunion - Suisse -
Tunisie - |
| |
Les origines étrangères :
 |
| |
|
 Les lettres de naturalité :
Les lettres de naturalité :
Sous l'Ancien Régime, les étrangers qui venaient s'installer en France
demandaient au roi une lettre de naturalité. Celle-ci avait pour premier
effet de supprimer un droit fort ancien, le droit d'aubaine, qui voulait
qu'au décès d'un étranger ses biens n'aillent pas à ses héritiers, mais au
roi lui-même !
Pour l'obtenir, l'étranger devait d'abord adresser une requête qui
était examinée par le Conseil du roi. |
|
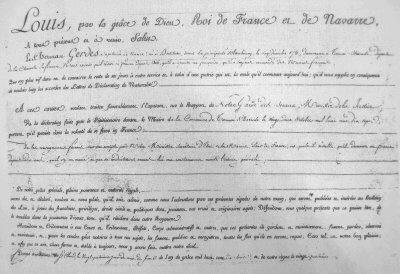 |
|
Lorsque la réponse était favorable, la lettre de naturalité était
rédigée par la Grande Chancellerie de France et le bénéficiaire devait
venir lui-même la retirer. Mais il fallait encore la faire vérifier par la
Chambre des Comptes, puis l'enregistrer par la Cour du Trésor. Tout au long de cette procédure, il pouvait en faire
établir des copies et les faire enregistrer également par le Parlement de
Paris, le Grand Conseil ou le Bureau des Finances. Ainsi de telles lettres
de naturalité se trouvent aujourd'hui conservées dans différents fonds
d'archives, sans qu'il y ait de règles fixe. A contrario, on ne pas être
assuré, lorsqu'on n'en trouve pas trace, qu'elle n'ait pas existé.
Ces lettres ne concernent naturellement que les personnes ayant une
situation sociale élevée. Elles sont fort intéressantes dans la mesure où
elles indiquent généralement les raisons qui amène le souverain à les
accorder et peuvent même reprendre la bibliographie du bénéficiaire. On y
retrouve de toute façon son origine, le nom de ses parents, ainsi que ceux
de son épouse et de ses enfants éventuels. |
| |
|
 Les dossiers de naturalisation :
Les dossiers de naturalisation :

Avec la fin de l'Ancien Régime, cette pratique va considérablement se
modifier et, si l'immigration de votre famille a moins de deux siècles,
vous allez pouvoir consulter un dossier de naturalisation.
Souvent ce dossier était précédé par une admission à domicile, c'est à
dire une autorisation de fixer son domicile en France, procédure
obligatoire de 1849 à 1927.
Ensuite, pour obtenir la nationalité française, il fallait remplir un
dossier fourni par la préfecture du département de résidence. Ce dossier,
qui est maintenant conservé aux archives départementales, est
particulièrement intéressant puisqu'il contient en général :
 Le questionnaire
rempli par l'intéressé, Le questionnaire
rempli par l'intéressé,
 un extrait de son
acte de naissance à l'étranger, avec une traduction éventuelle, ainsi que
ceux de son conjoint et de ses parents éventuels, un extrait de son
acte de naissance à l'étranger, avec une traduction éventuelle, ainsi que
ceux de son conjoint et de ses parents éventuels,
 des extraits de
feuilles d'imposition, qui renseignent sur sa situation financière, des extraits de
feuilles d'imposition, qui renseignent sur sa situation financière,
 une attestation
éventuelle de service militaire effectué dans le pays d'origine, une attestation
éventuelle de service militaire effectué dans le pays d'origine,
 un extrait de
casier judiciaire français, un extrait de
casier judiciaire français,
 des attestations
des employeurs successifs en France, des attestations
des employeurs successifs en France,
 une attestation du
maire de la commune de résidence certifiant que l'intéressé y habite bien
et depuis combien de temps. une attestation du
maire de la commune de résidence certifiant que l'intéressé y habite bien
et depuis combien de temps.
Enfin, ce dossier comprend également l'avis favorable donné par la
préfecture.
Mais, en même temps que le dossier était étudié à la préfecture, un autre
plus restreint était adressé au ministère de la Justice (jusqu'en 1945).
Ce second dossier, moins complet que le premier, est également intéressant
puisqu'il comprend le lettre manuscrite de demande d'admission à domicile
et éventuellement celle du conjoint, ainsi qu'un extrait d'acte de
mariage.
Ce dossier permet de connaître précisément l'origine à l'étranger de
l'ancêtre venu s'installer en France. Il faut alors y poursuivre les
recherches, ce qui hélas n'est pas toujours possible. |
| |
Les origines hors de la métropole :
 |
| |
|
Au fur et à mesure que la France prenait possession
de territoires hors de la métropole, elle y installait son administration
et en particulier l'état civil.
Mais, pour éviter que les archives ne se détériorent trop rapidement, un
édit de juin 1776 de Louis XIV créa à Versailles un " dépôt des chartes
des colonies " qui devait recueillir un double de tous les actes passés
aux colonies.
Cet édit était même rétroactif et obligeait les prêtres à recopier leurs
anciens registres pour en envoyer une copie à Versailles. Tous ne le
firent pas malheureusement, ou le firent très incomplètement. Les séries
les plus complètent concernent la Guadeloupe et le Réunion.
D'autres territoires rattachés à la France que plus tardivement, aussi
est-il nécessaire de les examiner séparément. |
| |
|
 Guadeloupe, Martinique, Réunion : le cas des
esclaves
Guadeloupe, Martinique, Réunion : le cas des
esclaves

Dans ces territoires, des registres différents (sauf exception)
enregistraient les actes des populations blanches et libres et ceux des
esclaves. Ces derniers n'avaient pas de nom de famille et n'étaient donc
inscrits que sous leur seul prénom, mais on précisait également ceux du
père et de la mère, ainsi que le nom de leur propriétaire.
Toutefois, l'usage d'un nom de famille s'introduisit progressivement au
XIXème siècle et fut rendu obligatoire en 1848. Des registres de
déclaration des "nouveaux libres" furent alors ouverts pour remplacer les
registres matricules où étaient inscrits précédemment les esclaves,
registres qui furent le plus souvent détruits. Dans ces nouveaux
registres, les anciens esclaves indiquaient un nom et leur prénom, et
souvent déclaraient une union antérieure. Aussi s'est trouvé régularisé
leur état civil.
L'absence de nom de famille rend malheureusement difficile la poursuite
d'une généalogie très antérieurement à l'abolition de l'esclavage, car
l'usage seuls de prénoms ne permet que rarement d'assurer les filiations. |
| |
|
 Algérie
Algérie

Etat civil -
Colonisation
-
Listes électorales et recensements
-
Transportés politiques -
Dossiers de fonctionnaires
Dès la conquête, l'état civil a été institué en Algérie. Celui-ci a été
tenu jusqu'en 1962.
Les registres, qui étaient comme en métropole tenus en double exemplaire,
sont restés sur place après l'indépendance, mais une campagne de
microfilmage a été lancée pour qu'une copie puisse être consultable en
France. En fit, les deux tiers seulement des registres l'ont été. Les
microfims sont conservés à Nantes au service central de l'état civil.
Précisons toutefois que ces microfilms ne concernent pas les musulmans.
Etat civil
Seul l'état
civil de plus de cent ans est conservé sous forme de microfilms à
Aix-en-Provence. Pour la période postérieure le lecteur s'adressera au
ministère des Affaires étrangères, service de l'état civil à Nantes :
service central de l'état civil 44941 Nantes cédex 09. Il faut
connaître avec certitude le nom de la commune où ont été dressés les actes
qui vous intéressent. Il faut ensuite déterminer la date de l'acte.
Les tables décennales de l'état civil qui sont établies par
communes et couvrent plusieurs années (généralement des périodes de dix
ans) récapitulent par ordre alphabétique les bénéficiaires d'actes. Elles
permettent de retrouver la date exacte d'un acte pour pouvoir consulter le
registre correspondant.
Pour l'Algérie il existe des tables pour:
 les communes du
département d'Alger: elles sont disponibles en accès libre sous forme de
microfilms (77 Miom) .
les communes du
département d'Alger: elles sont disponibles en accès libre sous forme de
microfilms (77 Miom) .
 Alger,
Bône, Blida, Oran, Philippeville: elles sont disponibles en accès libre
sous forme de registres (photocopies des tables originales) mais il y a de
nombreuses lacunes. Alger,
Bône, Blida, Oran, Philippeville: elles sont disponibles en accès libre
sous forme de registres (photocopies des tables originales) mais il y a de
nombreuses lacunes.
Quand vous connaissez la date exacte de l'acte que vous recherchez,
reportez-vous à l'inventaire pour trouver la cote du microfilm où est
reproduit l'acte que vous recherchez: 109 Miom 1 à 512 et 122 Miom 1 à 6
pour Guelma
 Microfilms des registres d'état
civil d'Algérie
Microfilms des registres d'état
civil d'Algérie
Aïn-Témouchent
Alger
Arzew
Batna
Blida
Bône
Boufarik
Bougie
Bouzaréa
La Calle
Cherchell
Constantine
Djidjelli
Douéra
El-Arrouch
El-Biar
Fort-de-l'Eau
Guelma
Hussein-Dey
Koléa
Marengo
Mascara
Médéa
Mers-el-Kébir
Miliana
Millesimo
Mostaganem
Mustapha
Oran
Philippeville
La Rassauta
Relizane
Les doubles des registres catholiques de
l'ex-département d'Alger couvrant la période 1840 à 1899 sont détenus
par le Monastère des Clarisses de Nîmes.
Les demandes de recherche
sont à adresser à :
La soeur archiviste Monastère des
Clarisses - 34, rue de Brunswick-30000
Nîmes-
Tel : 04.66.26.66.76
Colonisation

Pour
compléter vos recherches, vous pouvez également consulter les dossiers de
demandes de concession de terres:
 gouvernement général: série L (fichier nominatif par odre alphabétique des
concessionnaires)
gouvernement général: série L (fichier nominatif par odre alphabétique des
concessionnaires)
 départements
d'Alger, Oran, Constantine: série M (par département, par commune et par
ordre alphabétique des concessionnaires)
départements
d'Alger, Oran, Constantine: série M (par département, par commune et par
ordre alphabétique des concessionnaires)
Il existe
également des listes de départs ou de convois: série F 80 (par bateau, par
date de départ puis par ordre alphabétique des passagers)
Listes électorales et recensements
Il n'en existe que pour le département d'Oran. Série E pour les élections,
107 Miom pour les recensements (1906 et 1911)
Transportés politiques
Gouvernement général de l'Algérie: 10G
Oran: série continue 3060-3070
Dossiers de fonctionnaires

XIXe siècle: F 80 127-134
administrateurs: GGA 1G et H
personnel forestier: GGA 2P
personnel judiciaire: GGA 3T |
| |
|
 Afrique noire,
Indochine, Madagascar
Afrique noire,
Indochine, Madagascar

Pour les anciennes colonies n'ayant jamais eu le statut de département
comme l'Algérie, un double des registres d'état civil était envoyé en
métropole pour y être archivé. Ils sont maintenant consultables à Nantes.
Toutefois, ces registres ne concernent que la population d'origine
européenne. Pour les autochtones, des registres spécifiques étaient tenus.
Ils sont restés sur place et n'ont pas été microfilmés après le départ de
l'administration française. |
| |
|
 Maroc et Tunisie
Maroc et Tunisie

Ces pays n'ont pas été que sous protectorat français.
En ce qui concerne le Maroc, de 1915 à 1956, les registres ont été tenus
en trois, puis en deux exemplaires, dont un est conservé à Nantes.
Pour la Tunisie, de 1884 à 1956, les registres établis sont restés sur
place, mais des microfilms sont consultables à Nantes. Ils concernent
également la population tunisienne.
Avant la présence française et depuis 1956, l'état civil est consulaire
comme pour tous les pays étrangers. |
| |
|
Les pays francophones : |
|
Au cours de vos recherches, vous allez peut-être
rencontrer des ancêtres qui ont séjourné dans des pays francophones ou des
branches de votre famille qui ont émigré. Il ne sera pas difficile en
général d'y effectuer des recherches, dans la mesure où les documents que
trouverez sont très semblables aux nôtres.
Toutefois, un certain nombre de documents spécifiques méritent d'être
présentés pour chacun d'entre eux. |
| |
|
 Le Québec
Le Québec

Il accueillit la première émigration française notable. Toutefois,
celle-ci ne fut en fait jamais importante car nos rois craignaient de
dépeupler la France au profit d'une colonie lointaine et peu rentable.
Ainsi le Québec, appelé la Nouvelle France à l'époque, passa-t-il en 1763
sous domination anglaise, après que l'Acadie (provinces actuelles du
Nouveau-brunswick et de la Nouvelle-écosse) ait déjà été cédée en 1713 et
sa population déportée en 1755. La population francophone actuelle descend
de quelques milliers de pionniers et de soldats qui choisirent de rester
sur place lorsque leur régiment ont été démobilisés.
Au Québec, les religieux qui ont accompagné les premiers arrivants ont
naturellement respecter les règles d'enregistrement des baptêmes, mariages
et sépultures dans les registres paroissiaux. Ceux-ci, bien conservés dans
leur ensemble, sont la première source à consulter. Mais, en fait, vous
n'aurez même pas à le faire, car les canadiens francophones se sont, bien
avant nous, souciés d'établir leur généalogies et ont systématiquement
dépouillé leurs plus anciens registres.
Plusieurs publications ont été faites. Le dictionnaire généalogique de Mgr
Cyprien Tangay, établi au XIXème siècle et complété par la suite par
Arthur Leboeuf, rassemble environ 50 000 actes allant des origines à 1760.
Le Dictionnaire généalogique des familles du Québec, conçu par René Jetté,
couvre la période allant de 1603 à 1730 et contient des renseignements
tirés d'autres sources telle que les recensements et les actes notariaux.
Il est donc plus complet.
Enfin, un programme de recherche en démographie historique de l'université
de Montréal a permis la publication du répertoire complet des actes de
baptêmes, mariages et sépultures ainsi que des recensements du Québec des
origines à 1765.
De même, Histoire et généalogie des Anciens fournit des renseignements
très précis sur les familles qui s'étaient installées en Acadie.
Tandis que les prêtres tenaient leur registres, les autorités françaises,
puis anglaises, effectuaient périodiquement des recensements pour
connaître précisément l'importance de la colonie et connaître les noms de
ces habitants. Ceux-ci ont été nombreux aux XVIIème et XVIIIème siècles.
Certains fournissent d'intéressantes précisions sur les lieux de résidence
et de composition des familles. Au XIXème siècle, les recensements ont
enregistré également la religion, l'origine et la profession des
individus.
De même, les notaires rédigeaient les nombreux actes passés par les
habitants de la colonie et, en particulier, les concessions. En effet, le
régime seigneurial qui était en vigueur en France fut transposé au Québec,
de sorte que le roi octroyait de grandes seigneuries à des personnages
importants, qui les faisaient ensuite défricher et exploiter par des
censitaires, ainsi nommés parce que l'impôt qu'ils payaient était appelé
cens.
Il est ainsi possible de retrouver la date et l'endroit précis où se sont
installés les membres de votre famille partis au Québec. |
| |
|
 La Belgique
La Belgique

Ce pays, qui n'est que partiellement francophone, a été fortement
influencé, en ce qui concerne les recherches généalogiques, par
l'occupation française de 1792 sur l'état civil.
Antérieurement, des registres paroissiaux en tenait lieu. Toutefois, à la
différence de ce qui se pratiquait en France, ils étaient presque toujours
rédigés en latin. Ils sont également moins complets en ce qui concerne les
filiations.
Dès le début de l'occupation, ils ont été remis aux autorités civiles. A
la suite d'une loi de 1865, accordant des aides aux communes pour ce
travail, ils ont fait l'objet de tables alphabétiques, ce qui simplifie
leur consultation.
En 1814, à la fin de la présence française, les registres d'état civil ont
continué à être tenus. Toutefois, dans les parties flamandes du pays,,
l'usage du néerlandais a remplacé celui du français. Ces registres sont
complétés, comme en France, par des tables annuelles décennales.
D'autres documents sont naturellement utilisables pour l'établissement
d'une généalogie. Ainsi , il existe des registres de publication de bans
de mariage. A partir de 1880, on trouve également des registres supplétifs
concernant les adoptions, les divorces, les modifications d'état civil,
les naturalisations et les transcriptions d'actes survenus dans d'autres
communes.
Des registres de bourgeoisie, dans les villes, nous renseignent sur les
familles les aisées et des recensements nous permettent (à partir de 1846)
de connaître la composition des familles.
Enfin les registres notariaux sont, comme en France, une source
particulièrement importante.
Pour la consultation des fonds d'archives, on
distingue, comme en France :
 les Archives
générales du Royaume (rue de Ruysbroeck 2-10, B-1000 Bruxelles) qui
concernent les institutions centrales du pays et celles de l'ancienne
province et de l'ancien duché de Brabant; les Archives
générales du Royaume (rue de Ruysbroeck 2-10, B-1000 Bruxelles) qui
concernent les institutions centrales du pays et celles de l'ancienne
province et de l'ancien duché de Brabant;
 les Archives
de l'Etat dans les provinces, au nombre de quinze, qui correspondent à nos
archives départementales et conservent les documents les plus utiles aux
généalogistes, tels que les registres paroissiaux et d'état civil, les
fonds notariaux, les archives judiciaires, les recensements, les fonds
familiaux et, parfois, des collections généalogiques. les Archives
de l'Etat dans les provinces, au nombre de quinze, qui correspondent à nos
archives départementales et conservent les documents les plus utiles aux
généalogistes, tels que les registres paroissiaux et d'état civil, les
fonds notariaux, les archives judiciaires, les recensements, les fonds
familiaux et, parfois, des collections généalogiques.
 les Archives
communales des villes les plus importantes où vous trouverez les registres
de bourgeoisie, ceux des corporations et de nombreux livres ou documents
d'histoire locale. les Archives
communales des villes les plus importantes où vous trouverez les registres
de bourgeoisie, ceux des corporations et de nombreux livres ou documents
d'histoire locale.
Enfin, le Crédit communal de Belgique doit être
indiqué, car il dispose d'une importante bibliothèque (Bd. Pachéco 44,
B-1000 Bruxelles) qui contient un très grand nombre d'ouvrages historiques
et généalogique.
|
| |
|
 Le grand-duché de
Luxembourg
Le grand-duché de
Luxembourg

Ce pays, ayant été sous domination française de 1794 à 1815, en a gardé
certaines institution.
Toutefois, les registres paroissiaux sont restés dans les paroisses et
ceux de l'état civil dans les mairies. Mais de nombreux travaux
généalogiques ayant été publiés, vous aurez intérêt à vous rendre d'abord
aux Archives de l'Etat (plateau du Saint Esprit, chemin de la Corniche,
2010 Luxembourg) pour les consulter.
Vous y trouverez également des microfilms de tous les registres
paroissiaux antérieurs à 1815, ce qui vous évitera des déplacements dans
les paroisses, parfois difficiles à organiser. |
| |
|
 La Suisse
La Suisse

Unique en Europe sur bien des points, la Suisse l'est aussi pour les
recherches généalogiques.
En effet votre travail sera facilité, si vous devez effectuer la
généalogie d'une famille suisse, pAr l'existence du droit de bourgeoisie
dont bénéficient tous les citoyens de ce pays et leurs descendants, même
s'ils résident ailleurs depuis plusieurs générations. Ce droit de
bourgeoisie rattache toutes les familles, et donc tous leurs membres, à
une commune d'origine. C'est là que sont conservés tous les actes, et non
dans la commune où ils ont été rédigés. Ainsi il vous suffira de vous
rendre au berceau d'origine de la famille qui vous intéresse pour y
retrouver tous les actes la concernant !
Le lieu d'origine qui figure sur les papiers d'identité des citoyens
suisses peut-être trouvé si vous l'ignorez en consultant dans les archives
des cantons le "Répertoire des noms de famille suisses " qui précise
pour chacune la localité et l'ancienneté du droit de bourgeoisie.
En 1875, un état civil a été créé, mais il n'est pas librement
consultable. Il faut pouvoir prouver un lien de parenté et obtenir une
autorisation cantonale. Pour les périodes antérieures, les registres sont
conservés dans les paroisses ou ont été remis aux archives cantonales
auprès desquelles il faut se renseigner.
Enfin, rappelons que les recherches généalogiques sont pratiquées depuis
longtemps en Suisse et que de nombreuses et importantes publications
pourront peut-être vous apporter toutes les informations que vous cherchez
sans que vous ayez à entreprendre la moindre recherche. |
| |
Sources :
Editions Générales First 13-15, rue Buffon 75005
Paris
Je vous conseille le livre "ABSOLUMENT
TOUT SUR LE GENEALOGIE"
Vous pouvez également consulter les ouvrages du catalogue à l'URL
suivante :
http://www.efirst.com
|
| |